“Le sauvage et l’artifice”, schizophrénie japonaise
Dans son ouvrage, le géographe et orientaliste Augustin Berque souligne le rapport ambivalent qu’entretiennent les Japonais avec la nature.

© Claude Truong-Ngoc. Octobre 2014.
« La société japonaise a devant la nature un comportement contrasté. D’un côté elle tend à l’ignorer, qu’elle la laisse en l’état ou bien qu’elle la saccage ; de l’autre elle en fait sa valeur suprême et l’aboutissement de sa culture ». Dès la quatrième de couverture, le fil conducteur de l’ouvrage d’Augustin Berque, paru aux éditions Gallimard en 1986, commence à se tisser.
Le directeur d’études à l’EHESS, spécialiste du Japon, questionne ce grand écart nippon, à une époque où l’archipel est en plein boom, tant économique qu’urbanistique. À partir des années 1960-1970, la nature, vénérée et choyée par les Japonais, souffre aussi de leurs velléités d’expansion. Elle disparaît au profit des villes, qui elles-mêmes gagnent sur la mer. Dans ce pays où les saisons sont très marquées et souvent synonymes de fêtes populaires, comment expliquer un tel comportement ?
Sortir de ses systèmes de pensée
Après avoir détaillé avec une infime précision les différentes saisons dans l’archipel, leurs marqueurs et leurs coutumes, Augustin Berque soulève ce qui, pour lui, semble déterminant pour mener à bien cette réflexion sur les relations des Japonais à la nature : la définition même de celle-ci dans l’archipel. Car le principal écueil pour celui ou celle qui tenterait de comprendre ce qu’elle recouvre, serait de ne faire que calquer sa pensée et sa grille de lecture occidentales sur une société qui de toute évidence n’envisage pas la nature de la même manière.
Selon l’orientaliste, la nature au Japon recouvre à la fois le monde habité, où règnent les humains, et l’inhabité, où domine la nature la plus sauvage et intouchée, peuplée de divinités shintoïstes. Pour les Japonais, la nature est élevée au rang de « sujet », ce qui s’oppose à toute domination de l’homme sur cette dernière et à sa soumission. Et sous-tend l’impérieuse nécessité de vivre en harmonie avec elle, comme avec un sujet à part entière de la société nippone.
Le sauvage et l’artifice (1986), un essai d’Augustin Berque, publié aux éditions Gallimard.
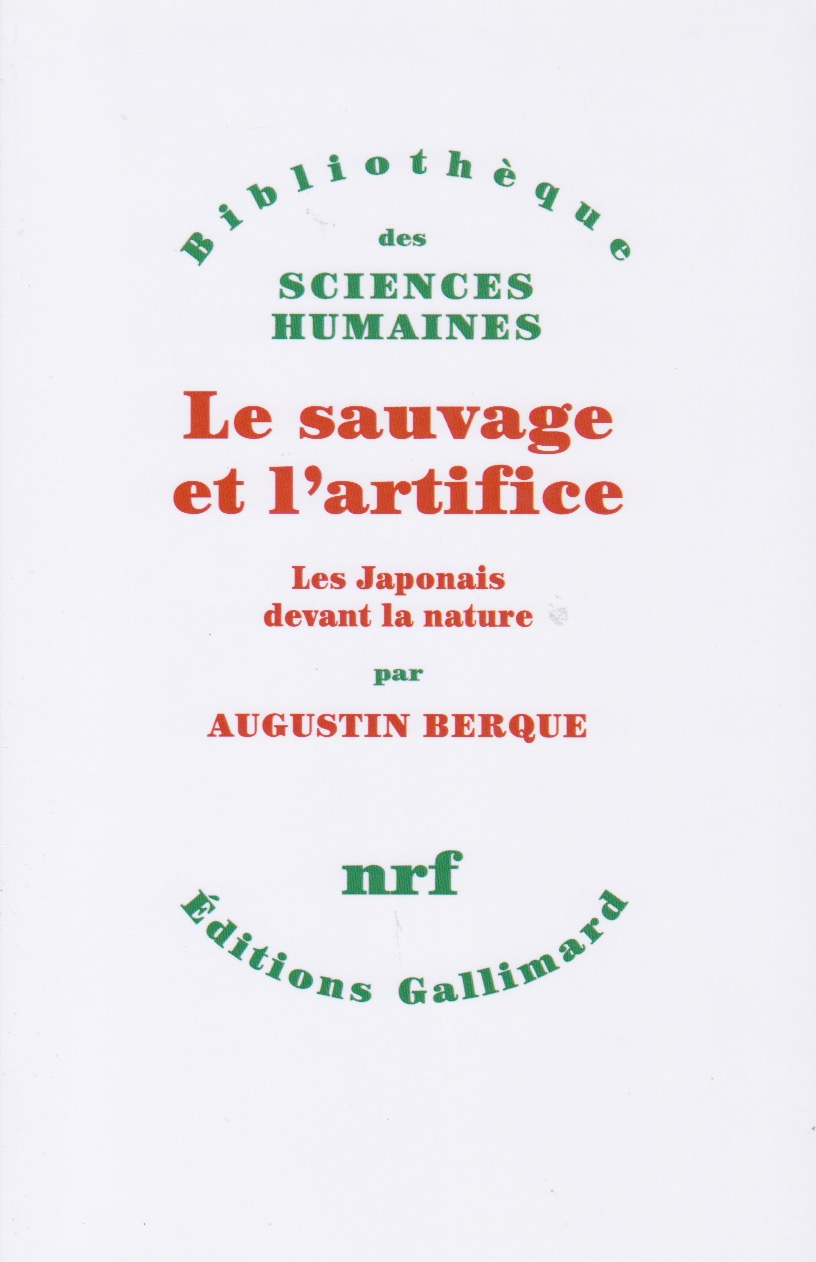
© Éditions Gallimard
LES PLUS POPULAIRES
-
“Mémoires d’une geisha”, déconstruction d’un fantasme
Inspiré d'une histoire vraie, le livre de Yuki Inoue offre un regard intime sur la vie de ces dames de compagnie au début du XXème siècle.

-
Un jardin japonais rare, caché au sein du temple Honen-in à Kyoto
Visible seulement deux fois par an, “Empty River”, aménagé par l’architecte paysagiste Marc Peter Keane, évoque le cycle du carbone.

-
La ville de Kurashiki, « petite Venise du Japon »
Le district de Bikan dans la ville de Kurashiki, avec la rivière Takahashi et ses nombreux canaux, a acquis la réputation d'être la Venise du Japon.

-
WaqWaq Kingdom, musique d'un folklore ultramoderne
Le duo de Shigeru Ishihara et Kiki Hitomi imprègne sa “club music” expérimentale et ses rythmes internationaux de mythologie japonaise.

-
Prodige de la sculpture sur sucre, Shinri Tezuka ranime une tradition ancestrale
Dans ses deux boutiques de Tokyo, l'artisan donne un nouveau souffle à l'art de l'“amezaiku”, qui consiste à sculpter des sucettes en sucre.





